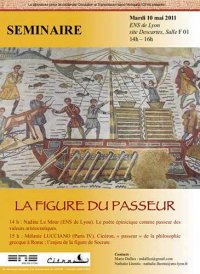Compte rendu de la séance du 10 mai 2011, élaboré par les membres du laboratoire junior CiTrA
Le fichier est téléchargeable au format .pdf. (PDF - 136 Ko).
Cette séance s’inscrit dans la continuité, d’une part de la séance qui avait porté sur les voies de communication dans l’Antiquité (réelles et symboliques), et d’autre part sur celle concernant les artistes sur les routes.
Dans l’Antiquité la figure du passeur la plus célèbre est sans doute celle de Charon, qui faisait traverser l’Achéron aux âmes des morts, pour rejoindre les enfers. Cette figure mythique renvoie à une pratique bien réelle, matérielle, du passage physique d’un lieu à un autre. Cet aspect de la question a récemment été traitée lors d’une journée d’études doctorales qui a eu lieu à Paris , intitulée : « Passages et figures de passeurs », ainsi que dans un ouvrage collectif paru en 2002 et consacré aux « Figures du passeur » (Carmignani, Paul (dir.), Figures du passeur, Perpignan, Presses Universitaires de Perpignan, 2002, 428 p).
Nous avons donc choisi de nous intéresser ici aux sens figurés du terme de « passeur », au passeur qui se fait le vecteur d’un lien « immatériel », entre les langues, les littératures et les civilisations du monde antique.
Le passeur auquel nous allons nous intéresser est celui qui va apporter un savoir, des connaissances inconnues d’un lieu à un autre, ou d’un temps à un autre, celui aussi qui va devoir, en même temps qu’il transmet, expliquer les choses. Un tel personnage soulève donc, entre autres, la question cruciale de l’altérité, qu’il va falloir dépasser pour pouvoir vraiment transmettre les connaissances.
Avec les interventions de :
Nadine Le Meur (ENS de Lyon), « Le poète épinicique, passeur des valeurs aristocratiques »
L’épinicie, ou ode triomphale, était un poème récité à l’occasion des grands concours panhelléniques, pour célébrer la victoire d’un athlète vainqueur. L’épinicie est une variété, poétique, du genre de l’enkomion (discours d’éloge), un genre bien illustré dans l’ensemble de la littérature grecque. L’athlète que célèbre l’ode a remporté une victoire personnelle, privée, lors des concours (agônes) qui avaient lieu lors des fêtes sacrées, panhelléniques.
L’ode est issue d’une commande privée, financée par un particulier (qu’il s’agisse de l’athlète lui-même ou de l’un de ses proches). La création d’une ode par un poète après une victoire n’est donc pas une pratique systématique, ni obligatoire : il ne s’agit pas d’une liturgie.
Un éloge communautaire : l’éloge des cités
Dans les odes, ce n’est pas le seul vainqueur qui est célébré, mais avec lui ses ancêtres, et surtout la cité dont il est originaire. (Ex : chez Pindare, (Olympique V) la victoire d’un citoyen de Camarine est avant tout le prétexte à chanter la cité de Camarine.)
L’épinicie est donc moins un éloge personnel que communautaire ; cet aspect communautaire est très ostentatoire, revendiqué dans le poème lui-même. Le vainqueur, un individu privé, semble s’effacer devant sa famille et sa cité. (Ex : toujours chez Pindare, la Pythique VII célèbre la victoire de Mégaclès d’Athènes, mais le nom même du vainqueur apparaît seulement au vers 16. Pindare a commencé par célébrer Athènes, puis les Alcméonides, le génos (famille, ou « clan » aristocratique) auquel appartenait Mégaclès.)
De même, la Pythique I, v. 31 affirme explicitement que Hiéron « donne du prestige » à Etna, sa cité. De nombreux exemples chez Pindare affirment et montrent que le prestige de la victoire rejaillit sur la cité du vainqueur.
Chez Bacchylide (par exemple Epinicie VI, v. 15) on trouve les mêmes conceptions que chez Pindare : la victoire de l’athlète glorifie la cité tout entière.
Monique Trédé et Suzanne Saïd ont montré que le genre épinicique est lié à la politique (la polis), même si c’est sur un autre mode que dans la tragédie attique classique. L’ode épinicique n’est pas, comme on l’affirme souvent, un genre exclusivement aristocratique.
Quelles valeurs ?
La première valeur est l’arèta (en dialecte dorien, celui dans lequel écrit Pindare), la valeur que le chant épinicique construit, valorise et transmet. Il s’agit d’une notion difficile à traduire en français.
On peut distinguer quatre catégories de sens à ce mot :
a) les « talents », la « force »
b) la « vaillance », le « courage »
c) la « gloire », la « réputation », le « renom »
d) au pluriel, il s’agit des « actes de vaillance », « succès », « exploits ».
Mais Michel Briand souligne que ces différenciations de sens (surtout les trois premières catégories), correspondent surtout à des distinctions modernes. Pour Pindare, l’aréta a une valeur globale, et ne distingue pas toutes ces catégories : l’athlète vainqueur est à la fois fort, courageux, pieux, etc… Cette excellence physique et morale est aussi associée à une excellence sociale et même financière. Les vainqueurs sont chez Pindare parés de tous les mérites : toutes les qualités vont ensemble (cf. Olympique II, v. 53-54).
C’est en faisant preuve de cette excellence dans tous les domaines que l’athlète va pouvoir triompher de son adversaire et remporter la victoire : ce sont ces valeurs qui fondent la victoire.
Le kléos ("honneur, gloire, prestige"…) est l’honneur auquel aspirent les participants aux concours sportifs. A la gloire « intrinsèque » de la victoire, se superpose la gloire d’être célébré dans une ode : le chant poétique va pérenniser cette gloire, lui conférer une dimension immortelle : le kléos.
Pindare développe abondamment cette idée que la célébration poétique est l’achèvement de la gloire agonistique (Cf. par exemple Isthmique VII, v. 7-19).
On atteint alors un troisième niveau de la gloire, qui est le renom : l’ode, l’hymne, font redire la valeur de l’athlète. On a ainsi une double itération de l’exploit.
La « bonne réputation », la renommée, est en effet un des biens les plus précieux pour un homme.
Là encore, chez Bacchylide, on trouve le même souci : il s’agit pour le vainqueur de se ménager la gloire ou le renom. Le plus beau sort que l’on puisse obtenir consiste dans le fait de susciter l’admiration d’un très grand nombre d’hommes.
La troisième valeur qui est chantée dans les épinicies est le doublet générosité-hospitalité. Ces deux notions occupent une place prééminente (cf. par exemple Isthmique VI, v. 69-70). Pindare loue aussi bien l’hospitalité d’individus (cf. Néméenne I), que celle de familles ou même de cités entières (Corinthe est célébrée pour son hospitalité dans Olympique XIII).
La solidarité et la générosité entre amis est particulièrement célébrée, à travers les concepts importants de philia (liens d’amitié) ou de xénia (liens d’hospitalité). Parmi les philoi (les amis) du vainqueur, se place le poète lui-même, qu’il ne faut pas négliger de rémunérer pour son ode. Pindare ne manque pas de le rappeler à plusieurs reprises (cf. Néméenne VII). Ce salaire, versé par le commanditaire au poète, entre dans une chaîne de compensations : l’ode est ainsi présentée comme une compensation de l’effort fourni par l’athlète, et en retour le salaire est vu comme la compensation de l’effort du poète.
L’éloge de l’hospitalité est un topos chez Pindare. Les relations avec les commanditaires de son ode sont placées sous le signe d’une xénia : un service rendu entre amis, du même ordre que l’hospitalité. Pindare appelle ainsi Hiéron, vainqueur qu’il célèbre dans une ode, son xénos (son « hôte »). Pindare proclame souvent la solidarité, la communauté qui unit le poète (lui-même donc) à ses philoi, ses xénoi, que sont les vainqueurs célébrés.
On retrouve donc dans l’épinicie toutes les valeurs aristocratiques qui étaient présentes déjà dans l’épopée, chez Homère (notamment dans les aristies) ou chez Théognis.
Chez Homère aussi se superposent deux niveaux de gloire : celle provenant des hauts faits accomplis par les héros en eux-mêmes, mais aussi la gloire qui provient de la célébration de ces exploits par l’aède. Là aussi, déjà, la gloire immortelle des héros venait du chant épique (cf. Iliade IX, v. 43).
Autre exemple illustrant la même importance accordée aux liens d’hospitalité : Iliade, VI v. 236-241. Dans ce passage, Diomède et Glaukos refusent de se battre l’un contre l’autre quand ils s’aperçoivent qu’ils ont entre eux des liens de xénia héréditaires. On peut aussi penser aux listes de cadeaux (qui renvoient au système de don/contre-don) entre les grands héros aristocratiques, qui témoignent là encore de pratiques de xénia.
On peut retrouver le pendant de ces pratiques dans l’Athènes démocratique avec la notion de megaloprepeia qui est exigée des liturges dans l’exercice de leurs fonctions.
La manifestation de ces valeurs.
Dans l’épopée, ces valeurs se manifestent à la guerre, et dans l’épinicie, aux concours athlétiques. Le parallèle est explicitement établi par l’épinicie elle-même. Ainsi, l’épreuve à laquelle se soumettent le guerrier et le sportif portent le même nom : ponos (peine, effort), ou aethlos (épreuve).
Dans la légende, Thersandre, le fils de Polynice (Olympique II, v. 43-45) s’est illustré à la fois dans les jeux de la jeunesse et dans les combats (cf. également Pythique I, v. 44-49 et Isthmique I).
En faisant rejaillir sur sa cité la gloire qu’il a acquise, l’athlète agit comme un guerrier : il s’agit dans les deux cas « d’un bel acte accompli avec effort dans l’intérêt commun. »
Ce parallèle tient sans doute aux conditions historiques et politico-sociales qui sont le cadre de la cité alors naissante. A ce moment de l’histoire grecque, il devient plus difficile pour les individus de se distinguer au cours du combat : le combat en duel, aristocratique, homérique, a disparu pour laisser place au principe de la phalange, où chacun individuellement doit tenir son rang pour espérer une victoire collective.
Le corollaire littéraire à ces innovations militaires et politiques est que la cité décourage voire interdit la célébration d’individus, surtout issus de grandes familles. On développe alors l’éloge collectif, en prose (epitaphios logos). L’épinicie est donc le dernier endroit où peut être célébré l’individu à titre personnel.
Qui possède ces valeurs ? Comment les obtenir ?
La généalogie va occuper une place importante dans l’ode épinicique. Théron est plusieurs fois célébré pour la lignée dont il est issu (Olympique II v. 7-8 et 46-47). On insiste sur la « racine » d’où le vainqueur est issu. Le chant de louange est au moins en partie légitimé par l’ascendance. L’hérédité joue un rôle primordial pour Pindare dans les capacités d’un individu. Cf. Olympique II, 86-88.
Pour Pindare, le concept de la phua, (la "nature", en dorien) a une importance capitale. Le poète dresse une opposition nette entre une sophia ("sagesse", ou "valeur") venant de la nature (phua), et des qualités acquises à l’issue d’un apprentissage, les aretai didaktai (Olympique IX, v. 104) qui sont moins souvent couronnées de succès. Pour Pindare « rien ne vaut les qualités naturelles ». Par ailleurs, il affirme clairement qu’il ne vaut pas la peine de parler des efforts qui ne sont pas couronnés de succès.
Les qualités inhérentes à la famille se manifestent soit de père en fils, soit en fonction d’une alternance des générations comparable à ce qu’on trouve dans la nature (Néméenne IX, v. 10). Cette idée qu’il existe une « loi de l’excellence naturelle » d’une famille impose aux jeunes de s’inscrire dans une continuité (cf. Isthmique III, 13-14 ; VIII, 65).
Quelle est la portée politique de l’ode triomphale ?
C’est un genre aristocratique : il s’agit de se distinguer du reste de la société. Mais la célébration de la famille est liée à celle de la cité, ce qui peut avoir une implication tendancieuse. Ce lien tend ainsi à montrer la prééminence sociale et politique des grandes familles dans le monde de la cité.
Dans les exemples que l’on a vus, c’est la gloire du vainqueur qui illustre la cité : il s’agit, selon Pernot (La Rhétorique de l’éloge dans le monde gréco-romain, 1994, p. 703) d’un « éloge inversé ». Dans la tradition habituelle encomiastique, on est honoré car on vient d’une famille ou d’une cité déjà illustre. L’épinicie défendrait ainsi l’idée qu’une personne privée (et donc aristocratique) joue un rôle essentiel dans la communauté (voir par exemple les images qu’on trouve dans l’Odyssée ou les Travaux et Jours sur le bon ou le mauvais roi). On peut peut-être également lire ce message politique dans le nom des athlètes : un nombre non négligeable de ces noms contient le terme -démos (peuple), comme Agesidamos ; Kléodamos ; Alexidamos…
Conclusion :
L’épinicie reste la seule forme de poésie individuelle possible pour les grandes familles. Elle est bien écrite par et pour des aristocrates, dont elle défend et transmet les valeurs. Mais l’épinicie porte aussi une sorte de contradiction : l’ode se veut privée, mais elle a vocation à être publique. Son paradoxe est de chanter les puissants, tout en affirmant et en transmettant les valeurs de solidarité de la communauté politique.
Mélanie Lucciano (Paris IV), « Cicéron, "passeur" de la philosophie grecque à Rome : l’enjeu de la figure de Socrate »
La notion de passage dans l’Antiquité évoque assez naturellement, dans la mythologie, le passage de l’Achéron, dans la barque de Charon. Un détail est important : dans l’Antiquité, le voyage est toujours payant. Il faut toujours payer son passage, son voyage. Le passage ne saurait être vu comme le simple déplacement d’un objet d’un territoire à l’autre.
Le passeur n’est-il qu’un véhicule contraignant, mais nécessaire ? Ou bien le passeur/le passage influe-t-il sur le contenu du message ? Chez Cicéron, le choix de Socrate comme passeur de la philosophie grecque est motivé par une spécificité de cette figure.
Cicéron, dans les Tusculanes I, 1-5, annonce clairement son projet de transmission de la philosophie grecque à Rome. Mais Cicéron est conscient que cela ne peut se faire tel quel.
Cicéron annonce explicitement qu’il veut faire œuvre de passeur. La démarche de Cicéron possède une dimension agonistique : il s’agit de se mesurer aux Grecs. Si les Latins ont besoin de créer un genre philosophique, ce n’est pas parce qu’ils ne comprennent pas le grec ou la philosophie grecque, mais c’est par volonté d’émulation. Cicéron veut offrir aux Romains le dernier volet de la culture générale qui leur manque. Il ne s’agit pas de créer une philosophie, mais d’illustrer la philosophie romaine.
Cette démarche se fait sur un arrière-fond de rivalité entre Grecs et Romains, mais émane aussi d’une volonté pédagogique de Cicéron. Enfin, il y a aussi pour lui l’idée d’une dimension politique à cette entreprise. Cicéron est donc un passeur qui se revendique comme tel, avec toutefois des choix qui lui sont particuliers.
Le choix du vecteur du philosophe athénien se justifie par sa forte présence dans l’œuvre de Cicéron (245 allusions spécifiques à Socrate), ainsi que par le traitement particulier que reçoit la figure de Socrate dans l’œuvre de Cicéron.
Cicéron en tant que passeur : détacher la figure socratique des sources grecques pour pouvoir la ressaisir
Pour Cicéron, le transfert du savoir philosophique peut bien sûr se faire par la traduction des œuvres grecques : Cicéron lui-même a traduit du grec vers le latin plusieurs textes philosophiques (de Platon notamment). Cet aspect de la question a déjà abondamment été étudié dans d’autres travaux : il n’en sera donc pas question ici.
Socrate en revanche n’a pas écrit : sa pensée est donc déjà passée par le crible de plusieurs passeurs (ses disciples Platon et Xénophon, Aristophane, les socratiques dits « mineurs », etc…). Socrate est donc une figure mouvante, plus « plastique », qui relève de traditions diverses.
Cicéron donne clairement ses sources (grecques), et montre qu’il a conscience que sa conception de Socrate est le croisement de plusieurs sources diverses. Cicéron sait donc faire un usage critique des sources dont il dispose : c’est une faculté qui se retrouve ailleurs dans l’oeuvre de l’Arpinate. Ainsi, l’action menée par Cicéron sur le texte de Xénophon indique une prise de distance par rapport à sa source.
Cicéron expose sa source, mais il remet en question ce qu’affirme Platon. Cicéron sait donc se détacher de ses sources pour les reprendre et se les réapproprier. En prenant ses distances avec les sources « canoniques » grecques, Cicéron devient lui-même une nouvelle source sur Socrate : il façonne ainsi un Socrate latin, le Socrate cicéronien.
Socrate : la construction du sage romain.
Cicéron paraît dominé par une double nostalgie : celle du mos maiorum, et celle de la vetus Graecia, symbolisée par Platon, Xénophon, etc… qui incarnent un « âge d’or » de la Grèce. La figure de Socrate est donc plus utile que celle de Platon, puisque Socrate symbolise le moment fondateur non de la philosophie, mais d’un certain mode de pensée qui caractérisera les écoles philosophiques classiques et hellénistiques.
Aucun philosophe postérieur à Socrate ne veut se détacher de l’héritage socratique, même si certains le critiquaient. La référence à Socrate porte la dimension de fondation (« la racine socratique »), d’Antiquité : c’est un trait vénérable, positif, propre à séduire les Romains.
Socrate se préoccupait beaucoup d’éthique, ce qui ne pouvait que plaire aux Romains. Ce qui manque aux Romains, ce n’est pas une philosophie, mais une mise en forme de leur philosophie, des œuvres « littéraires » (litterae) de philosophie. Cicéron clame bien haut que les Romains possèdent des valeurs philosophiques et morales. Il leur manque simplement le genre philosophique.
On pourrait penser que Socrate ne serait alors pas très important : il n’a lui-même rien écrit ! Or chez Cicéron, Socrate occupe un rang supérieur : il est même souvent placé avant Platon.
Chez Cicéron, Socrate ne se situe pas du côté de la dimension théorique, mais dans la pratique directe de la philosophie. Pour Cicéron, les Romains pratiquent déjà la philosophie, comme Socrate : c’est lui qui leur permettra de passer le cap de l’éthique réflexive. Socrate devient donc le point de passage entre éducation grecque et éducation romaine.
Le procès et la mort de Socrate sont souvent rapportés chez Cicéron : cet épisode saillant de l’existence du philosophe peut renvoyer à la grandeur d’âme et à la fermeté des Romains. Les Romains peuvent donc se reconnaître dans ce comportement socratique.
Il existe en réalité deux modalités dans l’adaptation de la figure de Socrate.
Dans le discours que tient Socrate face à ses juges, Cicéron lui prête les termes de « magnitudo animi », qui est une vertu de la nobilitas. Cette qualité est pour les Romains un mode d’expression de la gravitas, qui selon eux les caractérise, et qui fait partie du mos maiorum. C’est donc avant tout par son comportement (et non par ses idées ou ses spéculations) que Socrate peut s’assimiler à la classe dirigeante romaine. Socrate a évité dans son procès de se comporter avec superbia (mépris, hauteur) : il peut donc devenir un exemplum à suivre pour les Romains issus de bonnes familles.
La figure de Caton peut ainsi être mise en parallèle avec Socrate, en ce que les deux illustrent le bon comportement à adopter face à l’arrivée de la mort.
Cicéron met toutefois en avant la supériorité de la figure de Caton sur celle de Socrate, sans doute par « chauvinisme » romain avant tout. Mais il ne faut pas s’y tromper : la figure socratique est elle aussi valorisée. Le comportement de Socrate au moment de sa mort illustre bien le fait qu’il a appliqué ses principes philosophiques dans sa vie réelle. La comparaison de ces deux grandes figures, selon le principe des vases communicants, permet de parer chacun des valeurs de l’autre. Ainsi, Socrate se « romanise » pour venir s’intégrer aux valeurs du mos maiorum.
La modification de la figure socratique
Mais ce passage que fait faire Cicéron à Socrate n’est pas sans effet : Socrate se modifie en « devenant » romain. Certains des traits marquants de sa vie ou de sa personnalité sont gommés : ainsi, l’homosexualité de Socrate n’est pas rappelée chez les auteurs latins.
Mais il est des points qu’il est impossible de passer sous silence : la célèbre ironie est un point crucial de la personnalité et de la méthode philosophique de Socrate. Or, cette ironie, qui est un art de la dissimulation, pourrait passer pour de la légèreté, ou même pour de la fausseté, du mensonge de la part de Socrate.
L’ironie socratique est intimement liée au discours, mais dans le cadre des dialogues de Platon, ce n’est pas seulement un acte de parole : l’ironie est une étape dans le processus maïeutique, protreptique. Elle est essentielle dans la dialectique de Socrate, telle qu’elle nous est montrée par Platon. Socrate utilise ainsi l’ironie pour amener son interlocuteur à aborder le fond des choses, pour parvenir enfin à la sagesse. Même si Socrate paraît plaisanter, il s’agit en fait d’un processus sérieux, celui-ci permet d’arriver à la sagesse. Donc il n’est pas nécessairement contraire à la gravitas.
Chez Cicéron, ce thème subit pourtant une profonde modification. Ce dernier conçoit l’ironie avant tout comme un acte de langage : l’ironie est bien pour Cicéron une forme de dissimulatio (cf. De oratore II, LXVII, 270). L’ironie n’est pas vue comme une spécificité de la philosophie socratique, mais comme une simple figure de parole, qui se rapproche du delectare (plaire) plus que du docere (instruire). Il s’agit d’un moment-charnière dans le ressaisissement de l’ironie socratique : Cicéron a bien compris le mélange des tonalités, gravité et plaisanterie à la fois. Pourtant, il articule avant tout cette notion à un procédé de rhétorique qui convient plus à un orateur qu’à un philosophe. L’Arpinate n’a pas su intégrer ce concept éminemment socratique à la philosophie romaine. Cicéron est d’ailleurs le seul à tenter de l’intégrer : l’ironie se trouvera, par la suite, réduite à une simple figure de rhétorique. Nous sommes donc tributaires du passage effectué par Cicéron sur l’ironie socratique. Cicéron reste dépendant des trois fonctions de l’éloquence : en rattachant l’ironie au delectare, il n’a pu rendre à l’ironie le caractère sérieux qu’elle possédait, in fine, chez le Socrate de Platon. Par son caractère double, l’ironie socratique ne peut donc être totalement rattachée à la pensée romaine.
En rattachant l’ironie au delectare, Cicéron a du coup échoué à le rattacher au docere. Pour Cicéron, il est difficile de mêler sérieux et ironie. Cet exemple illustre bien deux éléments : les limites du transfert de la figure socratique dans le domaine romain d’une part, mais aussi, justement, l’action de Cicéron, le passeur, dans la construction de la figure de Socrate.
Conclusions
On ne peut concevoir l’idée de transfert culturel que comme une transformation de ce qui est transmis : on le voit bien avec la figure de Socrate.
En même temps, le passage d’un domaine à l’autre n’est jamais à sens unique : l’objet transmis n’est pas transmis tel quel, et d’un autre côté, cet objet ne demeure pas non plus passif, modifié par le passeur. Le phénomène à l’œuvre correspond davantage à un « métissage » : en contrepartie, Socrate est sans doute aussi un masque qu’utilise Cicéron pour faire passer ses propres conceptions philosophiques et/ou morales.